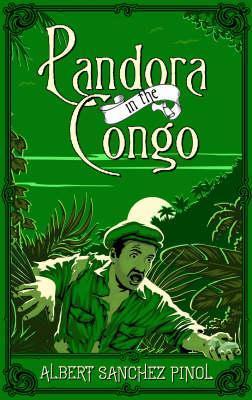Florence Maraninchi reviewed Pandore au Congo by Albert Sánchez Piñol
Ecriture ++, conclusions dérangeantes ?
5 stars
(Critique écrite en 2007 "à chaud")
Albert Sánchez Piñol est un anthropologue catalan, qui écrit en catalan. La traduction par Marianne Millon est un plaisir de lecture, et l'on peut penser que le texte d'origine l'est aussi. En tous cas, pour les éléments de style qui dépendent finalement peu de la langue, ce livre est un vrai bonheur, enlevé, spirituel, très fort dans la description des intrigues, des personnages et des ambiances (voir citations 1 et 2). On peut trouver que le roman inspire des conclusions dérangeantes, mais cela n'enlève rien à sa qualité, au contraire.
Sur le fond, que dire pour donner envie à d'autres lecteurs, mais sans pour autant dévoiler l'intrigue ? Il s'agit de confrontation entre peuples, entre l'Europe et l'Afrique, et/ou entre classes sociales en Angleterre au début du vingtième siècle. L'intrigue tourne autour du voyage au Congo de deux aristocrates incompétents en mal …
(Critique écrite en 2007 "à chaud")
Albert Sánchez Piñol est un anthropologue catalan, qui écrit en catalan. La traduction par Marianne Millon est un plaisir de lecture, et l'on peut penser que le texte d'origine l'est aussi. En tous cas, pour les éléments de style qui dépendent finalement peu de la langue, ce livre est un vrai bonheur, enlevé, spirituel, très fort dans la description des intrigues, des personnages et des ambiances (voir citations 1 et 2). On peut trouver que le roman inspire des conclusions dérangeantes, mais cela n'enlève rien à sa qualité, au contraire.
Sur le fond, que dire pour donner envie à d'autres lecteurs, mais sans pour autant dévoiler l'intrigue ? Il s'agit de confrontation entre peuples, entre l'Europe et l'Afrique, et/ou entre classes sociales en Angleterre au début du vingtième siècle. L'intrigue tourne autour du voyage au Congo de deux aristocrates incompétents en mal d'aventures, fuyant les conséquences de leurs actes en Angleterre et un quasi enfermement dans le château paternel. Ils s'improvisent chercheurs d'or ou de diamants dans une zone encore inexplorée du Congo, et sont accompagnés par un serviteur qui appartient à la couche tout en bas de l'échelle sociale anglaise... mais que l'on se refuse quand même à faire dormir dans la même chambre que les serviteurs noirs. Le serviteur anglais revient seul de ce voyage, et il est accusé d'avoir assassiné les deux aristocrates pour leur voler des diamants. Pour sa défense, il raconte sa version du voyage à un écrivain débutant, chargé par l'avocat de la mettre en forme pour influencer le déroulement du procès. Et ça marche : le livre est un succès, le serviteur est acquitté et reconnu comme un héros. Pour ne pas trop dévoiler l'histoire extraordinaire que raconte le serviteur, disons simplement qu'il décrit l'affrontement entre l'expédition (les anglais et tous leurs porteurs noirs recrutés en route après violences diverses) et un peuple encore inconnu. Les deux aristocrates y perdent la vie, malgré les efforts du héros. C'est l'avidité de l'expédition anglaise qui cause l'apparition de ce peuple, d'où le titre qui fait référence à Pandore. Dans cet affrontement, les frontières sociales se déplacent peu, les héros ne sont pas nécessairement les aristocrates, et la barrière entre les Noirs et les Blancs résiste décidément à beaucoup de choses (voir citation 3).
Ce récit de voyage mis en forme par l'écrivain est un livre dans le livre. "Pandore au Congo" est en fait construit comme l'histoire du jeune écrivain lui-même qui, à la fin de sa vie, soixante ans plus tard, réécrit ce livre qui avait fait son succès dans sa jeunesse. Il raconte aussi sa vie d'alors dans une pension de famille habitée (entre autres) par une tortue sans carapace qui se déplace à toute allure, un irlandais bruyant et une patronne vieille fille. Il raconte ses rapports orageux avec l'avocat qui l'a engagé. Il se permet de revenir sur certains points de son premier roman, il complète l'histoire du procès par des éléments ultérieurs, et il s'interroge sur la part qu'il a prise dans l'écriture : a-t-il simplement mis en forme un récit, ou bien a-t-il véritablement fait oeuvre littéraire ? La conclusion, en forme de pirouette, nous donne à penser que la différence entre une très bonne oeuvre littéraire et un roman de gare de 80 pages assemblé à coups de clichés ne réside en tout cas pas dans le scénario. Si le roman du voyage en Afrique du serviteur anglais est une oeuvre littéraire, c'est donc bien grâce à l'écrivain... ce qui conduit à penser qu'il est de son entière responsabilité d'avoir influencé le procès jusqu'à rendre possible l'acquittement. Doit-on se réjouir d'un tel pouvoir de la littérature ?
Une fois reposé le livre, on est tenté d'en tirer une sorte de morale, ou au moins de revenir sur les différents rebondissements de l'intrigue pour se demander : "que veut nous dire l'auteur, finalement ? ". Le livre à l'intérieur du livre a d'ailleurs suscité les mêmes interrogations en son temps : le jeune écrivain, qui travaille alors dans un journal à scandales, est confronté aux interprétations diverses et variées de son livre, avant que ses collègues n'apprennent qu'il en est l'auteur. Un des anciens du journal, connu pour ses diatribes contre le sionisme et le complot juif international, voit bien sûr dans le peuple inconnu une incarnation de ce complot. Et nous, qu'y aurions-nous vu ?
En tant que lecteur des deux histoires (le récit de voyage et la vie de l'écrivain) on s'interroge encore plus. Le récit de voyage, et ensuite la vie de l'écrivain, nous ont amenés à épouser deux visions assez antithétiques, à quelques 50 pages de distance. Il est donc assez naturel de se demander sur laquelle des deux l'auteur voulait que l'on reste... à supposer qu'il ait eu une telle intention. Mais précisons ces deux visions antithétiques. Dans la première on nous fait accepter un héros qui se sacrifie pour sauver l'humanité connue ; s'il est un héros c'est précisément parce qu'il se débrouille pour rendre impossible à tout jamais une nouvelle confrontation du peuple inconnu et des peuples connus. Emportés par l'histoire, on se "laisse avoir" tout d'abord, facilement et de plein gré, par cette vision des choses. Mais à tête reposée on s'interroge : que faut-il en déduire sur la confrontation violente entre l'Europe et l'Afrique, qui elle a déjà eu lieu et ne saurait être annulée ? Faut-il penser que lors de la première confrontation on a manqué d'un héros qui aurait coupé l'Afrique du monde à tout jamais ? Et pour protéger qui, l'Europe, ou l'Afrique ? 50 pages plus tard dans la deuxième vision apportée par l'histoire de l'écrivain, on retombe sur ses pieds : rien de nouveau sous le soleil, les héros ne sont pas si courants, la confiance peut être abusée. Mais cela n'efface pas la première vision, qui en quelque sorte définit la position du héros dans des circonstances de premier affrontement de deux peuples. Si finalement le héros auquel on nous avait fait croire n'existe pas, faut-il simplement regretter d'avoir été manipulés (ça vaut pour les contemporains du procès et pour nous), ou bien doit-on considérer que c'est la définition de la position du héros qui est remise en cause ?
Peut-être qu'attendre un message de l'auteur en réponse à cette question est illusoire. La morale de tout cela est peut-être simplement que l'on croit à ce qu'on veut bien croire. Quand vous l'aurez lu, interrogez-vous sur votre acceptation (ou non) du personnage du héros, dans toute la première partie. C'est cela qui est dérangeant.